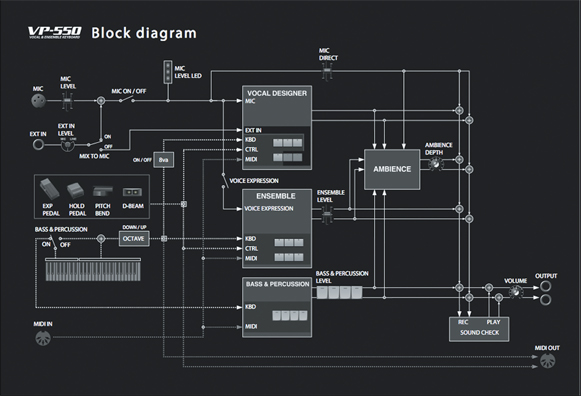Il est vain, à Paris, de monter sur ses grands chevaux ; ils ne mènent nulle part, et il n’y a plus d’allées cavalières.
Jérôme Garcin
Extrait de Lettres de rupture
Les murs me chuchotent que je leur appartiens et que je n’y peux rien. le bitume renvoie ses hydrocarbures aux bourgeons et aux premiers touristes. Belle Dame, tu brilles plus que jamais. Je sais que rien ne sera comme avant.
Rue Jacob, la fac de médecine et sa façade lisse, blanche et moche. qui me raconte le paysage blafard depuis ce fauteuil. Dos à la peinture de Bob, un voilier dans la tempête, une surface découpée, travaillée au couteau. Des vagues profondes de l’écume blanche, aérienne, ce talent inouï suspendu par une ficelle en coton jaunie par ces longues années de tabac.
Rue Jacob, de retour de voyage, j’ai voulu reprendre le fil urbain par un “Et avec ceci ? Ce sera tout ?” pincé. Oui, ce sera tout. Et je regrette déjà tous mes ailleurs.

Mes cellules qui avaient pris pour habitude d’être gorgées de vitamine D tombent immédiatement en carence entrainant tout mon corps dans une lutte épuisante. L’absence de murs, l’absence de déguisements dans ceux que j’ai vus, croisés, rencontrés, enfin cette impression. La valeur sure, le chaud du matin, la certitude du beau, du brulant et du soleil qui me rongeaient et m’avaient injecté le mal dans les veines m’avaient fait rentrer au pays et viennent me raconter que ce ne sera pas ailleurs ma vie, mais qu’ici tout ceci manquera sans fin, inlassablement.
Comme si la teinte d’ailleurs avait bousculée mes certitudes.
Juin, juillet, aout… Je rentre en ville lorsque tous partent.
Me voilà seule, dans ce grand appartement. 165 m² pour mon mètre 54, ça fait beaucoup, trop. Où sont-ils tous ? Je travaille, j’erre. je vis les textures. Cette moquette bleue marine dans la chambre du coin. le velours noir de ce grand canapé, cloué au sol, les ressorts du grand lit creux de la salle à manger, la paille fatiguée de toutes ces chaises, le lisse de ce formica couleur bois, l’aigre tabac dans ces voilures fades et partout le bois, de ce vieux parquet… Paris. l’été. Paris m’a oubliée parce que Paris je t’ai oublié.
Paris rancunière.
Moi aussi je regrette de t’aimer tant. Ce serait tellement simple de partir, de te quitter.